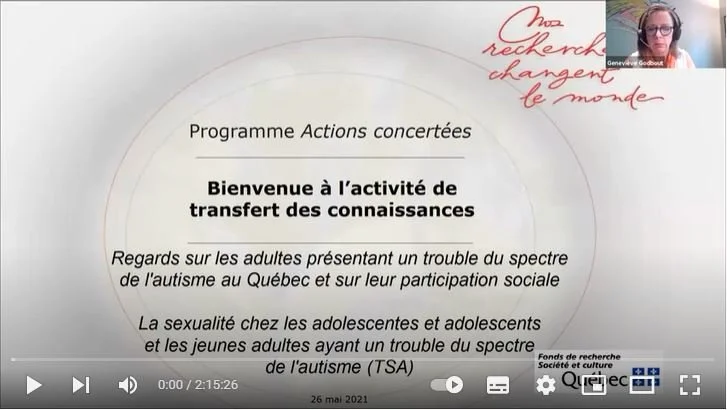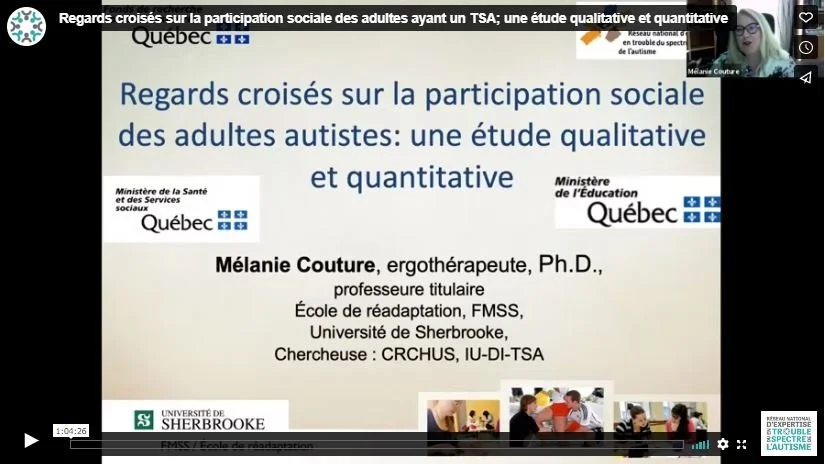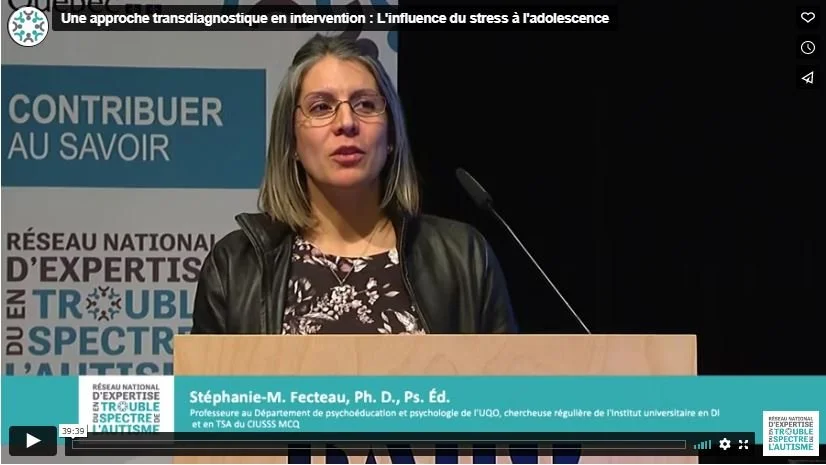Conférences grand public
3e édition du Symposium du GRAADA
Autisme et stigmatisation : comprendre et agir
Avril 2025
-
![]()
Webinaire sur la ménopause autistique
par Stéphanie Fecteau, Ph. D. et Christine A. Jenkins
Stéphanie Fecteau reçoit Christine A. Jenkins pour discuter de la ménopause autistique lors d'un webinaire post-symposium.
-
![]()
Résumé du portrait de la stigmatisation et de l'acceptation des personnes autistes et de leurs proches au Québec
par Lucila Guerrero, professionnelle en pair-aidance
La stigmatisation constitue un obstacle majeur à la construction de milieux inclusifs. Il est donc essentiel de disposer d’informations précises afin de mieux comprendre et réduire la stigmatisation et l’exclusion vécues par les personnes autistes.
Cette présentation met en lumière les résultats du rapport Portrait de la stigmatisation et de l'acceptation des personnes autistes et de leurs proches au Québec. Ce projet explore trois dimensions : la perception de la population québécoise, l’expérience des familles et des proches aidants, ainsi que celle des personnes autistes elles-mêmes.
Elle abordera les concepts liés à la stigmatisation, les méthodologies utilisées, les résultats obtenus et les recommandations formulées. De plus, ce portrait souligne l’importance de l’acceptation comme levier essentiel pour favoriser l’inclusion.
-
![]()
Identité et fierté autistes : résultats aux entrevues de diversité de paroles
par Isia Cloutier, B. Sc. et Gabriela Ovallé, partenaire-chercheure
Dans un monde à prédominance neurotypique, les personnes autistes peuvent parfois vivre de la stigmatisation et de l'exclusion. Dans un tel contexte, comment les personnes autistes se construisent-elles une identité positive et intègrent-elles le concept de fierté à leur différence ? Cette présentation met en lumière les résultats d'entrevues menées dans le cadre de l'étude « Diversité de paroles en autisme ». Parmi les personnes participantes, 14 adultes autistes ont pris part à des entrevues ayant pour objectif d'approfondir les thèmes de la terminologie en autisme, l'identité autiste, le handicap ainsi que la stigmatisation. La présentation qui suit fait état des réponses des personnes participantes aux thèmes de l'identité et de la fierté autistes. Les résultats suggèrent que les personnes autistes parviennent à se forger une identité positive et à être fières de réussir à naviguer dans une société qui n'est souvent pas adaptée à leurs besoins. Des thèmes tels que le camouflage, le sentiment de communauté et la neurodiversité seront abordés dans cette présentation mettant en évidence un besoin de sensibilisation de la société aux différentes réalités des personnes autistes.
-
![]()
Autism Identity: Exploring Stigma, Identity, and Self-Identification
par Simon Bury, Ph. D.
L'approche de l'identité sociale suggère que les individus tirent une partie de leur concept de soi des groupes sociaux auxquels ils appartiennent, ce qui influence leur bien-être, leur estime de soi et leur comportement. La recherche indique que l'adoption d'une identité autiste peut offrir des avantages similaires, notamment une meilleure estime de soi et des liens avec la communauté. Cependant, les menaces qui pèsent sur l'identité, telles que la stigmatisation, peuvent avoir un impact sur le degré d'identification à un groupe minoritaire et sur la manière dont les personnes choisissent d'exprimer cette identité. Cette présentation explorera l'impact de la stigmatisation sur la formation de l'identité autiste, l'adoption de descriptions de soi basées sur ses points forts, le phénomène de camouflage et l'adoption d'identités « plus sûres » telles que « neurodivergente ». En outre, il sera question du langage que les adultes autistes utilisent pour se décrire, en soulignant la nature complexe et évolutive de l'auto-identification autiste.
-
![]()
« Dans la peau d’une personne autiste » : sensibiliser par la réalité virtuelle
par Élise Douard, stagiaire post-doctorale à l’IUSMM
Cette présentation met en avant un projet de réalité virtuelle visant à sensibiliser le public aux défis quotidiens des personnes autistes. L’application « Dans la peau d’une personne autiste » propose une expérience immersive qui simule les défis sensoriels et sociaux auxquels ces personnes sont confrontées dans des environnements stressants, comme lors d’une visite chez le dentiste. Les résultats d'une étude menée sur 104 participants montrent que cette approche améliore significativement les attitudes, l'ouverture et la compréhension des participants envers l'autisme, indépendamment de leur degré de familiarité avec des personnes autistes. De plus, les témoignages des utilisateurs indiquent que cette expérience immersive favorise leur engagement pour une meilleure inclusion. Cet outil bilingue et gratuit vise à rendre accessibles et tangibles les réalités souvent invisibles des personnes autistes.
2e édition du Symposium du GRAADA
Diversité de paroles
Avril 2023
-
![]()
Résultats du sondage Diversité de paroles
par Stéphanie M. Fecteau, Ph. D., ps. ed. et Isia Cloutier, B. Sc.
Présentation des résultats du sondage Diversité de paroles dans lequel les préférences en terme de terminologie en autisme ont été abordées.
-
![]()
Être a/Autiste et période de questions
par Marjorie Désormeaux-Moreau, erg., Ph. D.
Trop souvent réduites au silence, les personnes a/Autistes ont historiquement été objets et non pas auteures des histoires ou productrices des connaissances qui les concernent. Conséquemment, ce qu’on pense savoir des a/Autistes et l’idée qu’on se fait de leur réalité, de leur vécu et de qui ils, elles ou iels sont est essentiellement inspiré du regard porté par des allistes (c.-à-d. des personnes non autistes). Ce contexte soulève des questionnements et des défis importants relativement aux statuts et aux identités qui se jouent, se négocient et se développent chez les a/Autistes, entres a/Autistes, entre a/Autistes et allistes et, plus largement, au sein de la société. Objet de la présentation : Reconnaissant l’importance des représentations sociales, mais également le caractère profondément idiosyncrasique de la construction et la protection de l’identité, cette présentation s’attardera à ce que c’est, qu’être a/Autiste. Elle abordera plus spécifiquement la façon dont estime de soi et sentiment d’appartenance se construisent sur la base d’identités attribuées et/ou choisies, de même que sur la base d’identités multiples, parfois irréconciliables.
Cette présentation est suivie d'une période de questions.
-
![]()
Résultats préliminaires des entrevues
par Marie-Hélène Poulin, Ph. D. et Jeanne Sauvé, B. Sc.
Présentation des résultats préliminaires des entrevues menées dans la cadre de l'étude Diversité de paroles ayant pour objectif d'identifier les termes les plus appropriés pour désigner les personnes autistes.
-
![Inclusion en emploi et période de questions]()
Inclusion en emploi et période de questions
par Valérie Martin, Ph. D.
Présentation des résultats de ses plus réceaux travaux dans son domaine d'expertise: l'inclusion en emploi des personnes autistes.
Sa présentation est suivie d'une période de questions.
1re édition du Symposium du GRAADA
Vers une vie adulte active
Octobre 2021
-
![]()
Mot de bienvenue de la Présidente d’honneur, Témoignage d’une réalité parentale, d’actions communautaires et politiques
par Mme la Députée Jennifer Maccarone
-
![]()
Portrait des obstacles et facilitateurs à la participation sociale des jeunes adultes autistes : état de la situation et recommandations.
par Mélanie Couture Ph. D.
Une enquête fut menée en 2018-2019 auprès de 209 autistes âgés de 16 à 40 ans et 130 parents d'autistes québécois du même âge. À cette enquête s'ajoute une série d'entrevues individuelles auprès de 10 adultes autistes et 11 parents, ainsi que des groupes de discussion auprès de 16 intervenants des milieux de la santé et communautaires. La combinaison de ces méthodes offre un portrait des obstacles à la participation sociale des jeunes autistes en transition vers la vie adulte, dont l'exclusion sociale, les environnements non adaptés, le besoin de soutien des familles, l'hermétisme des programmes et silos sectoriels. Complétée par l'identification de facilitateurs, cette étude propose une série de recommandations pour mieux soutenir la personne autiste en transition, sa famille et les intervenants les accompagnant.
-
![]()
Être un parent autiste - des forces et des défis qui invitent à reconsidérer la façon de percevoir et d’étudier l’expérience de la parentalité chez les adultes autistes.
par Marjorie Désormeaux-Moreau Ph. D.
Cette présentation portera sur l'expérience de la parentalité, telle que perçue et vécue par des adultes autistes. Les avantages ainsi que les défis rapportés seront d'abord abordés, puis l'écart entre les obstacles réellement rencontrés (pour beaucoup des barrières environnementales) et les ressources de soutien actuellement disponibles sera discuté. L'importance de la reconnaissance et de la mise en lumière du savoir expérientiel sera soulevée, permettant ainsi d'amorcer une réflexion quant à la manière de questionner les parents autistes sur leur réalité, leurs possibles défis et les pistes de solutions perçues comme pertinentes et alignées à leurs besoins. L'écart entre ce savoir expérientiel, de même que le savoir professionnel qui inspire l'offre de services et de soutien sera également abordé pour initier une réflexion quant à la manière dont les chercheurs gagneraient à se pencher sur de la réalité des parents autistes.
-
![]()
Co-construction avec les personnes autistes d’un outil s’intéressant à la relation fraternelle.
par Assumpta Ndengeyingoma Ph. D., Stéphanie-M. Fecteau Ph. D. et Germain Couture Ph. D.
La littérature actuelle documentant les relations fraternelles se basent en majorité uniquement du point de vue du frère ou de la soeur non autiste. Partant de la perception de jeunes adultes autistes des dimensions qui caractérisent leur relation avec leur frère ou leur soeur, nous élaborons un outil qui permettra de sonder la personne autiste en tant que membre actif dans cette relation. Jusqu'à présent, six jeunes adultes furent rencontrés à 3 reprises, menant à la co-rédaction de près d'une trentaine de questions composant l'outil. Nous avons recueilli la perception des participants de cette méthode de recherche participative. Celle-ci sera abordée et nous amène à considérer une telle approche en recherche comment étant riche pour toutes les parties prenantes et peut être aisément répliquée.
-
![]()
Médiation par les pairs et théâtre : un modèle de soutien social et d'inclusion pour les adultes présentant un trouble du spectre de l’autisme.
par Blythe Corbett Ph. D.
(EN) Peer mediation and theatre: a model of social support and inclusion for autistic adults SENSE Theatre is a peer mediated, theatre based intervention developed for autistic children, adolescents and adults. The key elements of the ten session intervention involve peers, play and performance, which provide a foundation of social support and inclusion. Theatre has the potential to provide a safe, creative space to engage in reciprocal social interaction and trained peers offer a supportive context in which to learn in community settings. Previous research using randomized clinical trials has shown significant impact in social cognition, communication, and reductions in anxiety following treatment.
-
![]()
L’écosystème d’Autisme sans limites : un modèle de soutien à l’inclusion des adultes autistes.
par Lise-Marie Gravel, directrice de l’organisme Autisme sans limites
Le modèle d'actions d'Autisme sans limites a été créé suite au constat que les jeunes adultes sont bien une fois qu'ils sont libres d'être eux-mêmes, autistes ou non. Afin de répondre aux besoins d'épanouissement de la jeune personne autiste, l'organisme offre une gamme de services et programmes ciblant l'inclusion de celle-ci dans la société, la promotion de la santé mentale, et le développement d'habiletés. Le modèle écosystémique implique les institutions phares et des acteurs clés de la communauté dans l'offre de services, les jeunes adultes autistes dans l'orientation et le développement des programmes et des jeunes étudiants bénévoles qui participent aux différentes activités inclusives. Cette présentation abordera l'actualisation du modèle d'actions et les impacts perçus auprès des participants autistes et non autistes.
-
![]()
Soutenir les jeunes ayant des besoins particuliers vers une vie adulte active : portrait de pratiques prometteuses de la Transition École Vie Adulte (TÉVA) au Québec.
par Chantal Desmarais Ph. D.
La TÉVA existe depuis plus de 20 ans dans les écoles Québécoises. En 2018, un guide interministériel (éducation, santé et emploi) a été publié, coïncidant avec le début de notre étude dont les objectifs étaient de recenser les écrits scientifiques sur la TÉVA en Amérique du Nord, de faire un scan du contenu TÉVA des sites internet des conseils de services scolaires et de mener des études de cas approfondies dans six écoles secondaires du Québec. Brièvement, il en ressort qu'une TÉVA optimale devrait inclure cinq composantes, soit une planification axée sur l'élève, l'engagement de la famille, un soutien au développement de l'élève, une collaboration intersectorielle et une structure de programme. De plus, nos données montrent que, si une équipe dédiée prend la TÉVA en main, un accompagnement de qualité peut être offert. Le défi demeure de s'assurer que tous ceux qui en ont besoin puissent en bénéficier.
-
![]()
La transition vers la vie adulte, planifiée avec l'élève : outils accessibles en lien avec les meilleures pratiques
par Francine Julien-Gauthier Ph. D. et Julie Ruel Ph. D.
La transition vers la vie adulte est celle qui a le plus d'impact sur la vie future du jeune ayant des besoins particuliers. Elle est considérée comme une transition complexe puisque toutes les sphères de la vie du futur adulte doivent être considérées. La planification concertée et intersectorielle de cette transition, réalisée avec le jeune et en fonction de ses intérêts, est une voie à privilégier. La communication fera connaître des outils accessibles sur Internet, adaptables et modifiables selon les caractéristiques des jeunes, qui soutiennent la démarche concertée de la transition. Pour chacune des composantes du cadre de référence pour des programmes TÉVA de qualité (Kohler et coll., 2016), ces outils concrets, développés dans le cadre d'une recherche-action, seront présentés. Leur utilisation sera ensuite illustrée à partir de résultats d'études scientifiques ou d'exemples réels de transition planifiée.
-
![]()
Un spectre de possibilités à découvrir.
par Julie Lahaye, directrice de l’organisme Intégration TSA
Créé à l'initiative d'un groupe de parents, Intégration TSA (ITSA) est un organisme à but non lucratif qui offre un milieu de formation adapté à une clientèle autiste de 21 ans et plus. À la fin des services scolaires, l'accès à des ressources spécialisées et adaptées à leurs besoins est limité. ITSA a comme mission d'accompagner les adultes autistes et leur famille lors de cette étape importante de transition qu'est le passage dans la vie adulte active. L'organisme adopte des pratiques innovantes en vue d'intégrer la clientèle autiste qui est en marge du marché du travail régulier. Pour ce faire, nous favoriserons le développement de l'employabilité à long terme en développant leur autonomie générale, et favoriser le développement et la consolidation des habiletés sociales nécessaires à la participation sociale et citoyenne. Des exemples de réussites et petites victoires tirées du quotidien de notre clientèle illustreront ces stratégies.
-
![]()
Faciliter l’intégration au cégep des étudiants autistes : Création d’un guide issu d’un partenariat entre le collégial et les services sociaux
Karine Lalonde, éducatrice spécialisée et Marie-Pier St-Jacques, éducatrice spécialisée programme TSA 7 ans +
Depuis 2017, une augmentation des inscriptions au centre de services adaptés des étudiants provenant de classes adaptées est constatée, ainsi qu'une croissance des défis en lien avec l'intégration et la réussite scolaire. Face aux besoins grandissants, un partenariat s'est établi entre le Centre de santé et de services sociaux de la Montérégie Ouest et le cégep Édouard Montpetit afin de mieux accompagner les étudiants autistes lors de cette transition. La présentation abordera les étapes menant à l'établissement de ce partenariat et les résultats de leur collaboration : ateliers offerts aux étudiants, Guide pour me préparer à remplir mon rôle de cégépien, visites guidées personnalisées, procédurier pour favoriser la réussite scolaire, grilles d'auto évaluation, etc. Les participants apprécient surtout les activités du volet social incluant le diner de groupe et le témoignage, ayant permis de créer un sentiment d'appartenance et diminuer l'anxiété face à la nouveauté.
Autres symposiums
-
La sexualité chez les adolescents, adolescentes et les jeunes adultes autistes
par Marie-Hélène Poulin, Ph. D., ps. ed.
Mai 2021
-
Regards croisés sur la participation sociale des adultes autistes : une étude qualitative et quantitative
par Mélanie Couture, Ph. D.
Mai 2021
-
Une approche transdiagnostique en intervention : l'influence du stress à l'adolescence
par Stéphanie-M. Fecteau, Ph. D., ps. ed.
Septembre 2019